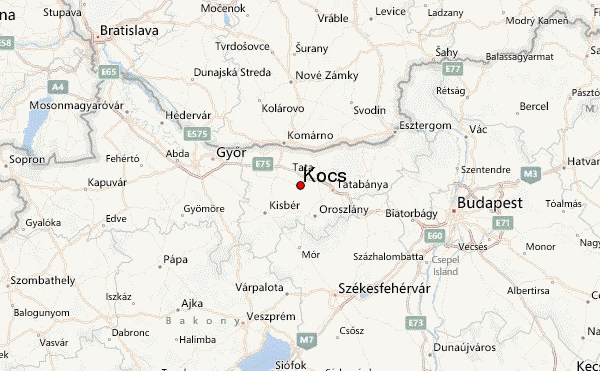Articles
La philosophie accorHom
Chez accorHom, l’accompagnement ne commence pas par un format, mais par une compétence humaine à développer.
Communication, qualité relationnelle et leadership sont les 3 piliers sur lesquels reposent l’engagement, la coopération et la performance durable dans les organisations.
Formations, accompagnements d'équipes, coachings et médiations sont mobilisés de manière pragmatique et sur mesure en fonction de votre contexte, de vos enjeux et de vos attentes.
Commettre une erreur ? C’est cadeau pour l’apprentissage.
« Errare humanum est… », disaient les romains ! Nous le savons depuis fort longtemps, la nature humaine n’est pas parfaite, l’homme commet donc des erreurs. A défaut de pouvoir être parfait, nous avons le pouvoir de corriger nos erreurs, de faire de notre mieux, et ainsi de tendre à l’excellence ! Selon comment l’on gère l’erreur, elle va devenir source d’apprentissage ou de méfiance… C’est en donnant un feedback respectueux à la personne qui a commis une erreur (sans jugement ni condamnation) que l’on favorise le processus de correction, d’apprentissage et donc d’excellence ! Donner une sanction ou une punition contribue à contrario à la démotivation dont on connaît bien les conséquences.
Un bref rappel du déroulement en quatre étapes d’un feedback respectueux :
- Je décris à la personne concernée ce que j’observe, vois, entends… (les faits concrets) au niveau de son comportement au travail, sans appréciation ni jugement : « quand je t’entends dire…, quand je te vois accueillir…, etc… »
3. Je décris les besoins éveillés en moi : « parce que je trouve important de…, parce que j’ai besoin de…, parce que c’est essentiel pour notre entreprise de…, etc… »
4. Enfin, je formule une demande de façon à ce que mon besoin ou celui de mon organisation puisse être satisfait dans le respect de celui de l’autre personne également : « est-il possible pour toi de … ? peux-tu veiller à… ? est-du d’accord de… ? »
Donner le droit à l’erreur déclenche un sentiment de confiance, ce qui favorise le processus d’apprentissage et d’engagement ! Tout aussi important, donner du feedback dans des situations positives en suivant le même déroulement en quatre étapes favorise un sentiment de reconnaissance qui agit à son tour positivement sur la motivation… d’apprendre et de s’engager. CQFD
Accepter l’erreur, c’est encourager et accélérer l’apprentissage
Rendre votre communication en entreprise inspirante et touchante
accorHom aide les personnes désirant développer leur sens de la communication à devenir des orateurs inspirants en participant à son atelier innovant « Au delà des mots ».
Le but : découvrir et pratiquer trois composantes de la communication non verbale pour les incorporer dans une présentation : le langage gestuel, le langage émotionnel ainsi que la mise en récit.
Le résultat : être capable de rendre un message vivant, se donner la confiance nécessaire pour communiquer avec aisance et ainsi toucher son audience.
Le déroulement : 2 journées consécutives à choix accueillant de 6 à 8 personnes afin de privilégier la qualité de l’apprentissage pratique.
La valeur : vivre une expérience humaine unique, passionnante et de plus amusante pour communiquer en ayant du plaisir à le faire !
La motivation ? Rien d’autre que notre carburant !
La motivation de l’être humain est une composante importante dans nos organisations professionnelles, et pour cause, c’est elle qui détermine son niveau d’efficacité. Son fonctionnement mérite une attention toute particulière afin d’interagir le plus adroitement possible dans nos organisations, ce qui se répercutera positivement tant sur l’engagement individuel que sur l’intelligence collective. Voici une piste sur le pourquoi et le comment ?
1. La motivation
Elle trouve son origine dans les raisons, les intérêts et les éléments qui poussent tout individu dans son action. La notion de « pousser » explicite très clairement le fait que l’impulsion, la source, provient de l’individu lui-même et non de toute autre personne qui chercherait à le motiver !Nous pouvons distinguer deux types de motivation, l’intrinsèque et l’extrinsèque, toujours selon Deci & Ryan (réf. Edward L. Deci & Richard M. Ryan – Intrinsic motivation and self-determination in human behavior -1985) :
Tout d’abord, il est important de se rappeler que ce qui pousse toute personne à agir va dans le sens de veiller à satisfaire ses besoins psychologiques fondamentaux (Deci & Ryan) qui sont au nombre de trois :
- la motivation intrinsèque s’explique par l’intérêt que représente la pratique d’une activité pour elle-même, en l’absence de toute récompense extérieure. La cause est interne à l’individu. Cette motivation procure un sentiment de compétence, de valeur personnelle, de détermination et de responsabilité à celui qui la ressent.
- la motivation extrinsèque est en lien avec l’engagement dans une activité en vue de retirer quelque chose de plaisant ou d’éviter quelque chose de déplaisant. Elle provient donc de l’extérieur. Elle a, par essence, une fonction instrumentale et présente le risque de créer un dépendance.
Tout d’abord, il est important de se rappeler que ce qui pousse toute personne à agir va dans le sens de veiller à satisfaire ses besoins psychologiques fondamentaux (Deci & Ryan) qui sont au nombre de trois :
- Le besoin de compétence, d’expression de capacités.
- Le besoin d’autonomie, d’auto-direction.
- Le besoin d’affiliation, d’appartenance, d’équité.
Tout(e) responsable d’équipe ou d’organisation peut promouvoir cette dynamique en distribuant suffisamment de pouvoir et d’autorité aux personnes à s’organiser par elles-mêmes autour de leur mission et à pouvoir se contrôler de l’intérieur. Cela crée du sens à leur travail. « Comment créer un environnement où les personnes se motivent elles-mêmes ? » devient LA question, plutôt que « Comment motiver les personnes ? ».
« Il est possible d’obtenir des autres ce dont on a besoin en les contrôlant. Ce faisant, on contribue à ce qu’ils ne se contrôlent pas eux-mêmes parce que ne se sentant pas responsables de leurs actions ».
En ce sens, l’être humain représente bien plus le capital de l’organisation, de l’entreprise, qu’une ressource (RH) ! Il en est sa plus grande richesse. Alors, prenons-en soin ! Bienveillance et savoir-être ne peuvent qu’augmenter sa motivation.
« Motiver, s’est inverser le sens de l’énergie » (F. Proust)
Le plaisir au travail, mode d’emploi !
Dans la continuité de l’article par lequel je tentais de décortiquer le fonctionnement de la motivation, tentons d’approcher ici ce qui peut favoriser le plaisir au travail, j’ai plutôt envie de dire le plaisir dans l’exercice de notre activité professionnelle…
Au-delà de pouvoir choisir une activité qui soit en cohérence avec nos centres d’intérêt, nos passions, voire notre rêve personnel, ce qui va nous procurer du plaisir d’une manière intrinsèque, il existe d’autres moyens nous permettant d’actionner la dynamique du plaisir au sein de toute organisation professionnelle. En voici quelques-uns :
- Construire pour l’entreprise, un rêve, une raison d’être, une mission, un « Business Dream », comme dirait Jean-Luc Tremblay http://jeanluctremblay.com/index.php dans ses interventions, avant même d’échafauder le « Business plan » !
- Co-créer une culture d’entreprise forte. Elle est la colonne vertébrale de l’entreprise qui comporte les valeurs humaines et les comportements reconnus par l’ensemble des personnes qui y sont actives. Car vivre et partager des valeurs communes en travaillant procure du plaisir.
- Communiquer clairement et régulièrement la raison d’être et les fondements de la culture d’entreprise de façon à ce que la compréhension en soit la même pour tous les protagonistes.
- Développer et cultiver le savoir-être entre les personnes et les partenaires de l’entreprise de façon à privilégier le respect mutuel. Inspirons-nous de Marshall Rosenberg et de sa méthode de « Communication Non Violente » pour contribuer à ce que les besoins de tous les acteurs puissent être satisfaits grâce à la dynamique des accords. Le plaisir en découle sans aucun doute.
- Encourager et entretenir la vraie écoute. Ce qui peut paraître un détail pour les uns peut être un point très important pour les autres, dû à des cadres de référence qui diffèrent d’une personne à l’autre. Ecouter, respecter et comprendre l’avis, ou le problème, de l’autre sans jugement lui permettra de se sentir considéré, donc…
- Exprimer régulièrement de la reconnaissance aux personnes qui contribuent à la réalisation de la mission de l’entreprise. Plus que de dire simplement « merci » ou « bravo », leur dire surtout concrètement en quoi leur coopération a contribué à l’accomplissement de la mission.
- Promouvoir la prise de décision par concertation. Distribuer le pouvoir de décider à toutes les personnes qui sont aux manœuvres, à celles qui savent…, rendra aussi l’entreprise plus agile, plus à même de s’adapter rapidement aux changements permanents.
Le moteur d’une équipe ? Ses équipiers !
Un des grands défis actuels dans nos organisations consiste à repenser notre façon de collaborer pour donner plus de sens à nos activités et devenir plus efficaces ensemble.
Pourquoi cette transition ?
Je constate régulièrement dans les entreprises et les organisations que les personnes occupent des postes qui ont été réfléchis et prédéfinis par la hiérarchie. A ces postes correspondent cahiers des charges (travail, ouvrage, à faire dans un temps déterminé) ou descriptions de poste, que les personnes en place vont tant bien que mal tenter de respecter et adopter. Du coup, l’activité se résume trop régulièrement à la seule exécution de tâches, parfois orientées vers tel ou tel objectif quantitatif. On est dans ce cas typiquement en présence d’une culture du savoir-faire, qui entraîne très rapidement démotivation et lassitude. Ce qui, en finalité, va desservir les intérêts de l’entreprise.
Comment s’y mettre ?Et si, et si…, nous inversions ce processus ! Que ce soient les personnes en place qui puissent agréer des rôles (un rôle est une entité organisationnelle comportant une mission à accomplir, un domaine d’activité à contrôler et des redevabilités à remplir) avec les responsables, dans un climat de confiance et non de contrôle. Elles peuvent ainsi réfléchir et décider par elles-mêmes des actions et des activités à réaliser pour les besoins de l’entreprise, de l’unité, en s’appuyant sur leurs talents et leurs compétences. Avoir cette autonomie et cette responsabilité d’agir crée la motivation intrinsèque qui rend pour tout un chacun le travail plus intéressant ! Incluons le savoir-être dans nos cultures d’entreprise ! Il présente le double avantage de favoriser un engagement plus constant et de contribuer à un savoir-faire d’excellence.
« Placer le savoir-être au service du savoir-faire »
Franchir le pas !
Oui, cette transition nécessite du courage (agir avec le cœur) et de la confiance (y croire ensemble). Mais pas seulement ! Monter une colonne vertébrale qui servira de structure et de langage commun à toutes les parties prenantes est essentiel pour que l’ensemble devienne cohérent. Ce modèle peut comporter les trois bases suivantes :
- Communiquer clairement et régulièrement la raison d’être, la vision et la mission de son organisation, de son unité, à toutes les personnes impliquées pour favoriser une compréhension homogène et une adhésion optimale de tous.
- Passer des accords très clairs avec toutes les personnes sur les rôles et leur distribution permettant à la raison d’être de l’organisation, de l’unité, de se réaliser.
- Veiller à ce que les besoins psychologiques des personnes actives puissent être satisfaits avant ceux de l’entreprise.
Alors pourquoi encore attendre de « donner pour mieux recevoir » ?
Et si nous remplacions la Tâche par un Rôle !
« Errare humanum est… », disaient les romains ! Nous le savons depuis fort longtemps, la nature humaine n’est pas parfaite, l’homme commet donc des erreurs. A défaut de pouvoir être parfait, nous avons le pouvoir de corriger nos erreurs, de faire de notre mieux, et ainsi de tendre à l’excellence ! Selon comment l’on gère l’erreur, elle va devenir source d’apprentissage ou de méfiance… C’est en donnant un feedback respectueux à la personne qui a commis une erreur (sans jugement ni condamnation) que l’on favorise le processus de correction, d’apprentissage et donc d’excellence ! Donner une sanction ou une punition contribue à contrario à la démotivation dont on connaît bien les conséquences.
Un bref rappel du déroulement en quatre étapes d’un feedback évolutif respectueux :
1. Je décris à la personne concernée ce que j’observe, vois, entends… (les faits concrets) au niveau de son comportement au travail, sans appréciation ni jugement :
« quand je t’entends dire…, quand je te vois accueillir…, etc… »
1. Je décris à la personne concernée ce que j’observe, vois, entends… (les faits concrets) au niveau de son comportement au travail, sans appréciation ni jugement :
« quand je t’entends dire…, quand je te vois accueillir…, etc… »
2. Je lui explique le(s) sentiment(s) que cela déclenche en moi :
« ça provoque en moi une déception…, un énervement…, de la tristesse, etc… »
3. Je décris les besoins éveillés en moi :
« parce que je trouve important de…, parce que j’ai besoin de…, parce que c’est essentiel pour notre entreprise de…, etc… »
4. Enfin, je formule une demande de façon à ce que mon besoin ou celui de mon organisation puisse être satisfait dans le respect de celui de l’autre personne également :
« est-il possible pour toi de … ? peux-tu veiller à… ? est-du d’accord de… ? »
Donner le droit à l’erreur déclenche un sentiment de confiance, ce qui favorise le processus d’apprentissage et d’engagement ! Tout aussi important, donner du feedback dans des situations positives en suivant le même déroulement en quatre étapes favorise un sentiment de reconnaissance qui agit à son tour positivement sur la motivation… d’apprendre et de s’engager. CQFD
Accepter l’erreur, c’est encourager et accélérer l’apprentissage
Pourquoi les émotions ont toute leur place en entreprise ?
Parce que… l’émotion (ex movere) est un signal physiologique exprimé par notre corps qui nous indique que l’un de nos besoins fondamentaux est satisfait ou pas. Selon Paul Eckman, nous connaissons six émotions de base que sont la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégout. Chacune d’entre elles est positive dans la mesure où elle nous sont utile. Les émotions se manifestent pour nous protéger et nous inciter à agir pour concrétiser ce qui est important à nos yeux.
La joie nous indique être en présence d’un événement heureux pour le célébrer ; la peur nous indique être en présence d’un danger et nous incite à se protéger ; la colère révèle une agression et nous délivre l’énergie nécessaire à nous défendre ; la tristesse apparait lors d’une perte nous facilite son acceptation. Toutes ces manifestations sont universelles et innées, elles font partie de tout être humain.
La raison pour laquelle il est donc vital de prendre en compte nos émotions, plutôt que de les refouler comme souvent appris, se trouve dans le fait qu’elles nous poussent à agir. Les réguler, à savoir les accueillir, reconnaître et exprimer, engendre la motivation (movere) à agir pour combler nos besoins fondamentaux et ainsi nous porter le mieux possible. C’est la magie du vivant qui est en chacun de nous.
Rapporté à l’environnement professionnel, toute personne qui prend en compte ses émotions peut ainsi veiller à satisfaire ses besoins et se sentir plus motivée. Elle développe plus d’élan dans son rôle et sa mission professionnelle, ce qui devient bénéfique tant pour elle que pour l’organisation dont elle fait partie.
La règle des 3 P en entreprise ?
J’ai découvert à l’occasion d’une conférence que la notion de développement durable a été clairement transposée au monde de l’entreprise. Ce processus a été nommé « Triple Bottom Line » (référence au Bottom Line, en français dernière ligne du compte de résultat d’un bilan comptable) par John Elkington. Il a cofondé en 1994 le cabinet de conseil en stratégie de développement durable britannique « SustainAbility ». Ce principe de gouvernance d’entreprise a ensuite été désigné en tant que règle des 3 P « People, Planet, Profit ». En voici sa signification :
1. People – Personnes
Respect des fondamentaux humains et prise en compte des conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour l’ensemble des parties prenantes.
Respect des fondamentaux humains et prise en compte des conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour l’ensemble des parties prenantes.
2. Planet – Planète
Responsabilité quant aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise sur le climat, l’exploitation des ressources naturelles renouvelables et/ou fossiles, donc épuisables, le traitement des déchets, le maintien de la biodiversité naturelle et la protection des eaux.
Responsabilité quant aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise sur le climat, l’exploitation des ressources naturelles renouvelables et/ou fossiles, donc épuisables, le traitement des déchets, le maintien de la biodiversité naturelle et la protection des eaux.
3. Profit – Profit
Recherche légitime du profit financier en tant que conséquence de la réalisation de la vision, de la mission et de la raison d’être de l’entreprise, dans le respect des règles éthiques.
Recherche légitime du profit financier en tant que conséquence de la réalisation de la vision, de la mission et de la raison d’être de l’entreprise, dans le respect des règles éthiques.
Une précision encore : tout développement peut être qualifié de durable lorsqu’il répond aux besoins des parties prenantes.Pour les organisations intéressées, il existe ce groupement : B Corp Switzerland
Du management pyramidal vers la gouvernance partagée…
Comment diriger les entreprises et les organisations ? On lit et on entend beaucoup sur ce sujet, preuve que nous ressentons le besoin d’évoluer ! Quel est l’enjeu ?
La mutation permanente que vit notre société implique une accélération du rythme des changements. Dans ces conditions le système de management pyramidal, qui a largement fait ses preuves au niveau du processus d’exécution, rencontre de plus en plus de difficultés à gérer la grande quantité d’informations qui circule de la tête à la base des entreprises et de fait il devient moins habile au niveau du processus de décision.
Pour développer leur agilité, nos entreprises ont tout intérêt à transformer le modèle de management hiérarchique en gouvernance distribuée, modèle qui relève du « comment être » et du « comment faire » ensemble, en réseau, dans le but commun de réussir ce qui réunit les personnes qui y travaillent. Définir comment partager et répartir les responsabilités, les rôles, le pouvoir et le processus de décision en tenant compte des intérêts de tous les partenaires que sont les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les patrons/propriétaires de l’entreprise permet à cette dernière de développer son agilité et de s’adapter plus rapidement aux changement continu.
L’origine du mot gouvernance est très ancienne. Elle nous vient du verbe grec « kubernân » qui signifie piloter un navire ou un char. La gouvernance implique donc un phénomène intéressant, celui du mouvement, du déplacement. Ce terme a refait surface depuis les années 90 afin de réguler l’ouverture des marchés en essayant de maintenir des finalités supérieures et non uniquement mercantiles ou financières (Enron & co…).
Pour être distribuée efficacement, la gouvernance doit reposer sur 4 principes :
- La confiance
- La responsabilité
- La transparence
- L’équité
Le temps est venu de « libérer les structures en structurant les libertés » !
Oser dire les choses… à chaud !
Je constate régulièrement chez les personnes que j’accompagne que leurs frustrations, leurs souffrances, au travail ou dans leur vie privée proviennent de la difficulté à pouvoir dire les choses, de plus à chaud, dans leur relations aux autres.
C’est le droit de s’affirmer !
En fait, dire les choses ne consiste en rien d’autre qu’à s’affirmer, c’est-à-dire à se comporter en nous respectant tel que nous sommes, si possible en toute situation.
C’est vrai, exprimer son avis, son désaccord ou encore son accord n’est pas toujours chose facile, et pour cause ! Nous avons vite tendance à reporter sur l’autre, sur les autres, la ou les pensées que nous avons lors de nos interactions. Nous formulons alors rapidement des opinions, voire des jugements, ce que l’on appelle la communication type « klaxon » ! (Tu as raison, tu as tort, tu me fais plaisir, tu m’énerves, tu …, tu …) et alors, selon notre tempérament, on préfère ne rien dire !
Le risque devient grand de ressasser et ressasser encore ces impasses relationnelles pendant des semaines et des semaines jusqu’à regretter de ne pas avoir dit les choses plus tôt. Ah, si au moins j’avais un peu plus de répartie ! Pas très bon pour l’estime de soi, reconnaissons-le !
Eh bien, il y a une recette ! Oui, nous pouvons parfaitement dire les choses à chaud sans risquer le dérapage relationnel ! L’art de le faire bien s’appelle l’assertivité : oser s’exprimer, savoir dire non, savoir demander. Être assertif, c’est savoir se positionner en respectant autant son interlocuteur que soi-même. C’est POSSIBLE !
Dans le cas d’un différend relationnel, communiquer clairement ce que l’on sent à l’intérieur de soi, ses sentiments, plutôt que son opinion (par exemple : j’ai été surpris par tes paroles…). On n’implique que soi tout en laissant l’autre exister face à soi. (Nos parents nous l’exprimaient ainsi : on ne dit pas : c’est pas bon ! On dit : JE n’aime pas !)
La Coopération au service de l’intelligence collective !
Pour être profitables, certaines organisations évaluent et valorisent la performance individuelle en versant notamment des récompenses à caractère individuel, telles des commissions et/ou bonus. Ces entreprises prônent pourtant le travail en équipe ! A la longue, cette forme d’encouragement engendre un esprit de compétition entre les personnes, y compris au sein d’une même équipe ! L’effet ? Au lieu d’être partagée au profit du groupe, l’information est retenue par ses membres dans leur propre intérêt. A force, chacun tire à sa corde et la performance de l’équipe diminue.
Quoi faire ? Transférer la gestion de la performance de l’individu au groupe, voilà la solution !
Prévoir un système de récompense attribuée exclusivement à l’équipe, par exemple, l’idée étant de partager le bonus en fonction d’une clé de répartition agréée. Regardons-y maintenant un peu plus en profondeur ! En effet, nous pouvons avant tout développer l’intelligence collective (= réunion des compétences et capacités d’une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres).
Comment faire ? Promouvoir l’adhésion à la mission et aux valeurs de l’entreprise, donner aux personnes la possibilité de dresser un état des lieux complet et régulier sur la façon dont le travail est organisé, les laisser réfléchir ensemble pour formuler leurs idées d’amélioration, prendre en compte leurs besoins (ça booste leur motivation à s’engager), autrement dit, les encourager à « coopérer ». Quand on se sent libre de s’exprimer, on se sent valorisé et du coup plus concerné par la raison d’être de son entreprise.
De cette dynamique, de ces synergies humaines, la performance collective découlera assurément et durablement.
Le "Pouvoir " et ces 3 facettes dans nos relations humaines.
A bien y regarder, le pouvoir est une notion à géométrie variable. Oui, absolument, nous avons la possibilité d’en faire usage de trois façons bien différentes. Je les décris à la première personne :
Le pouvoir « SOUS »
Il est présent dans les contextes relationnels où je me trouve en situation de soumission, d’impuissance et du coup de perte d’élan. L’attention, la caméra, est portée sur l’AUTRE qui sait ce qui est bon, ou pas, pour moi.
Le pouvoir « SUR »
Celui-ci trouve sa place dans les situations où j’ai des exigences, où je fonctionne en mode binaire (tu as raison/tu as tort). Ce pouvoir me procure un sentiment de domination, fréquent dans les organisations de type hiérarchique. L’attention, la caméra, est portée sur MOI, je sais ce qui est juste, ou pas, pour l’autre.
Le pouvoir « AVEC »
J’exerce ce pouvoir lorsque je suis ouvert, ouvert à l’autre, à sa perception des choses. Je favorise la co-création telle une danse où les partenaires expriment pleinement leur personnalité pour progresser ensemble d’une manière cohérente. Je favorise l’assertivité, c’est à dire que je suis capable d’exprimer mes besoins, de défendre mes droits, tout en reconnaissant et en respectant ceux des autres. L’attention, la caméra, est portée sur NOUS, sur le groupe. La recherche du OK pour tous est prioritaire.
Nous voyons immédiatement ici les limites que procure l’usage des deux premiers genres de pouvoir dans le cadre de nos relations, que ce soit dans notre environnement privé ou professionnel. En revanche, l’utilisation du pouvoir « AVEC », appelons le « 3ème pouvoir » encourage la richesse de la pluralité. Ce pouvoir devient une ressource facilitant l’intelligence collective au sein de toute organisation. D’ailleurs, nommé partagé ou distribué, il constitue une composante importante des nouvelles philosophies de gouvernance telle que pratiquées au sein des entreprise dites libérées, ou des organisations de type opale (Teal organizations) ou encore de toute constitution de type « holacracy ». Il est une source importante de motivation et plaisir retrouvés au travail.
Au fait, le coaching…, c’est quoi ?
Précisément, le mot « coaching » provient du vieux français « coche« , lui-même dérivé du hongrois « kocsi » voulant dire « voiture transportant des voyageurs » (Kocs, village du nord-ouest de la Hongrie, fut célèbre autrefois dans toute l’Europe pour la qualité des charrettes, carrosses et autres diligences que l’on y fabriquait).
C'est pourquoi la prestation de coaching consiste à accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’évolution d’une situation Avers une situation B qu’elle, ou le groupe, a choisi.
La personne coachée définit le but, l’objectif, à atteindre et prend la responsabilité du résultat. De son côté, le coach assume la responsabilité du processus par lequel la personne coachée est amenée à mobiliser ses ressources personnelles et à élaborer sa propre solution.
Ainsi, la prestation de coaching se caractérise essentiellement par le fait que la solution est élaborée par le client, ce qui la différencie de la prestation de consulting ou de conseil.
Qu’est-ce qui se cache derrière le mot holistique ?
Médecine holistique, coaching holistique, vous avez certainement déjà entendu ce mot qui peut paraître quelque peu ésotérique. Eh bien, il n’en est rien !
Expression qui nous vient en grande partie du Canada, le qualificatif holistique dérive de l’adjectif grec « holos » qui se traduit par « tout entier ». Rapporté à l’être humain que nous sommes, il précise les quatre dimensions fondamentales dans lesquelles nous révélons toute notre complexité, mais nous compartimentons aussi très couramment :
- la dimension physique qui n’est autre que l’incarnation de notre être.
- la dimension émotionnelle qui nous alerte sur la satisfaction, ou non, de nos besoins fondamentaux.
- la dimension spirituelle relevant de l’esprit, qui est le siège de nos valeurs, de nos croyances, de notre intuition, entre autres.
- la dimension intellectuelle qui réunit tout le raisonné et toutes les connaissances acquises. Dimension trop souvent dominante dans notre société.